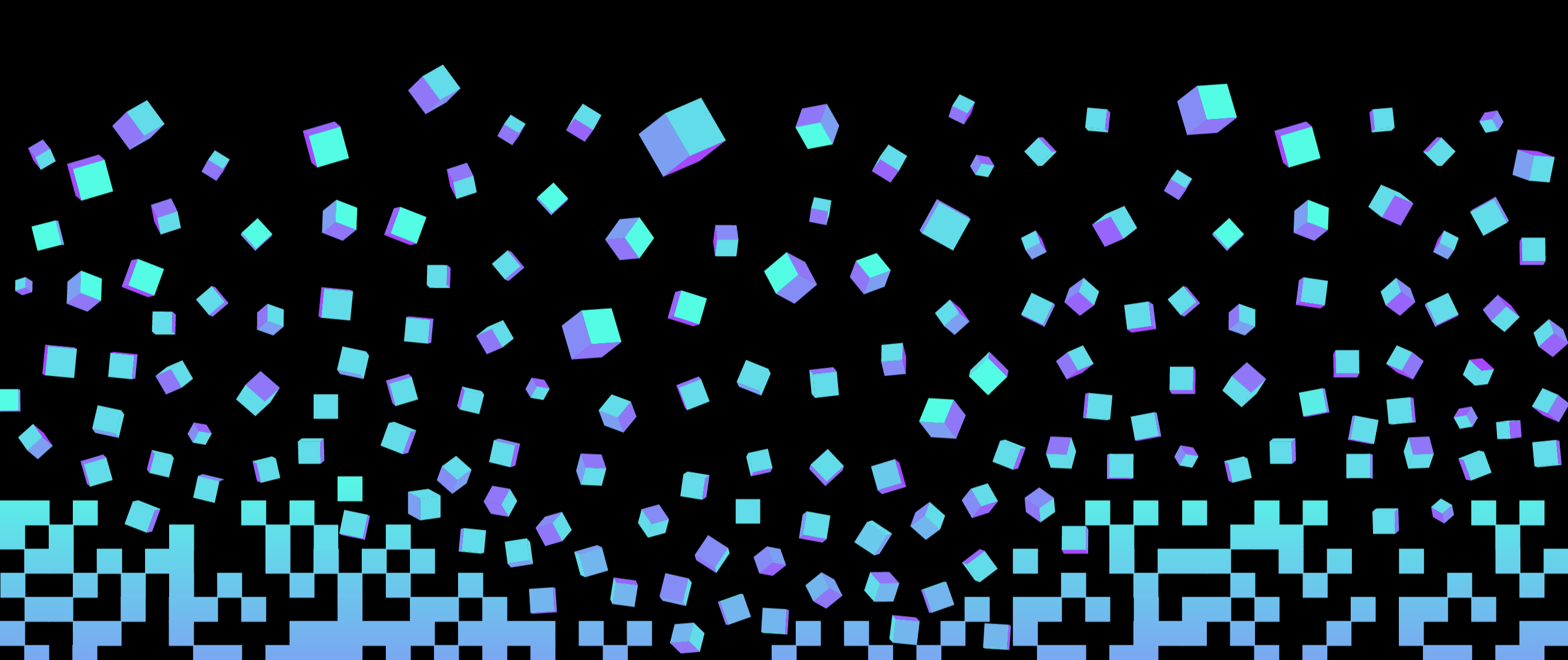
Travailler en création numérique : évolution des métiers graphiques 2D-3D et enjeux de formation
Par SYNTHÈSE - Pôle Image Québec
2021-12-01
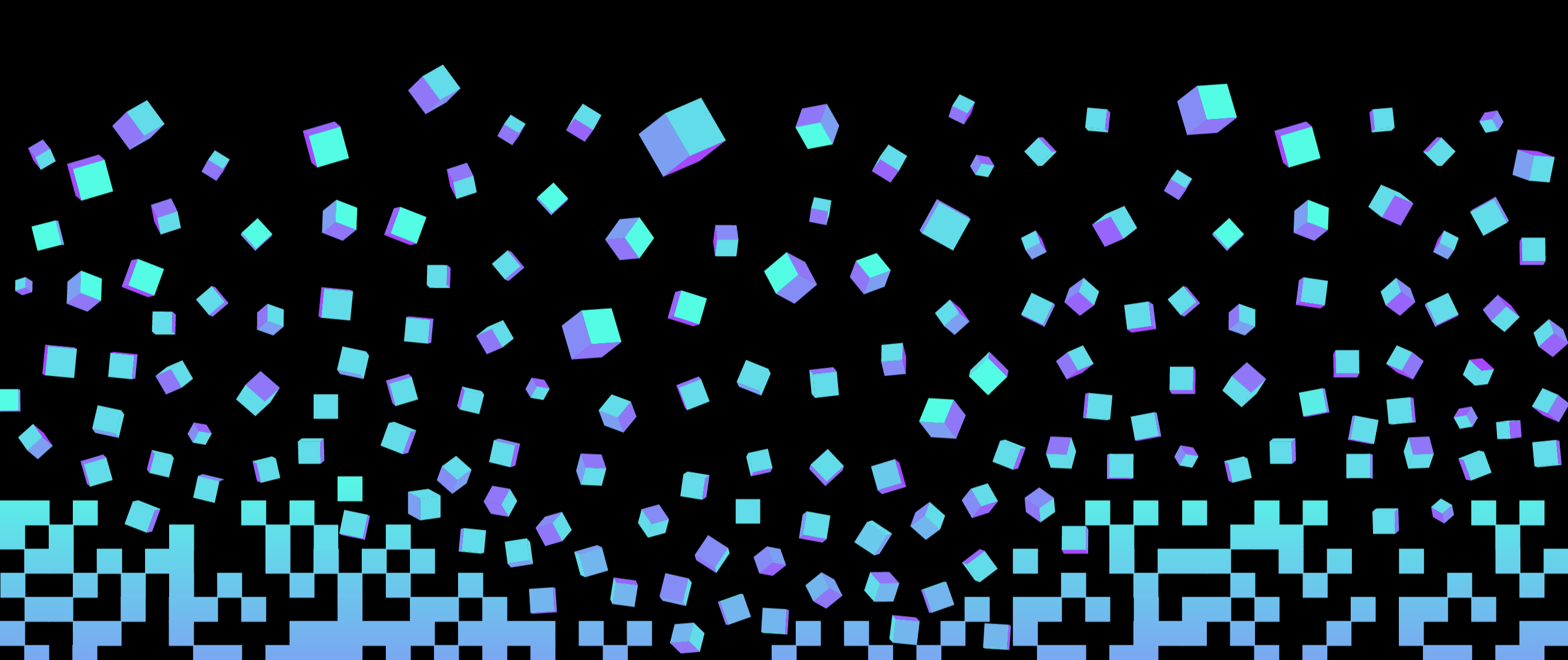
Par SYNTHÈSE - Pôle Image Québec
2021-12-01
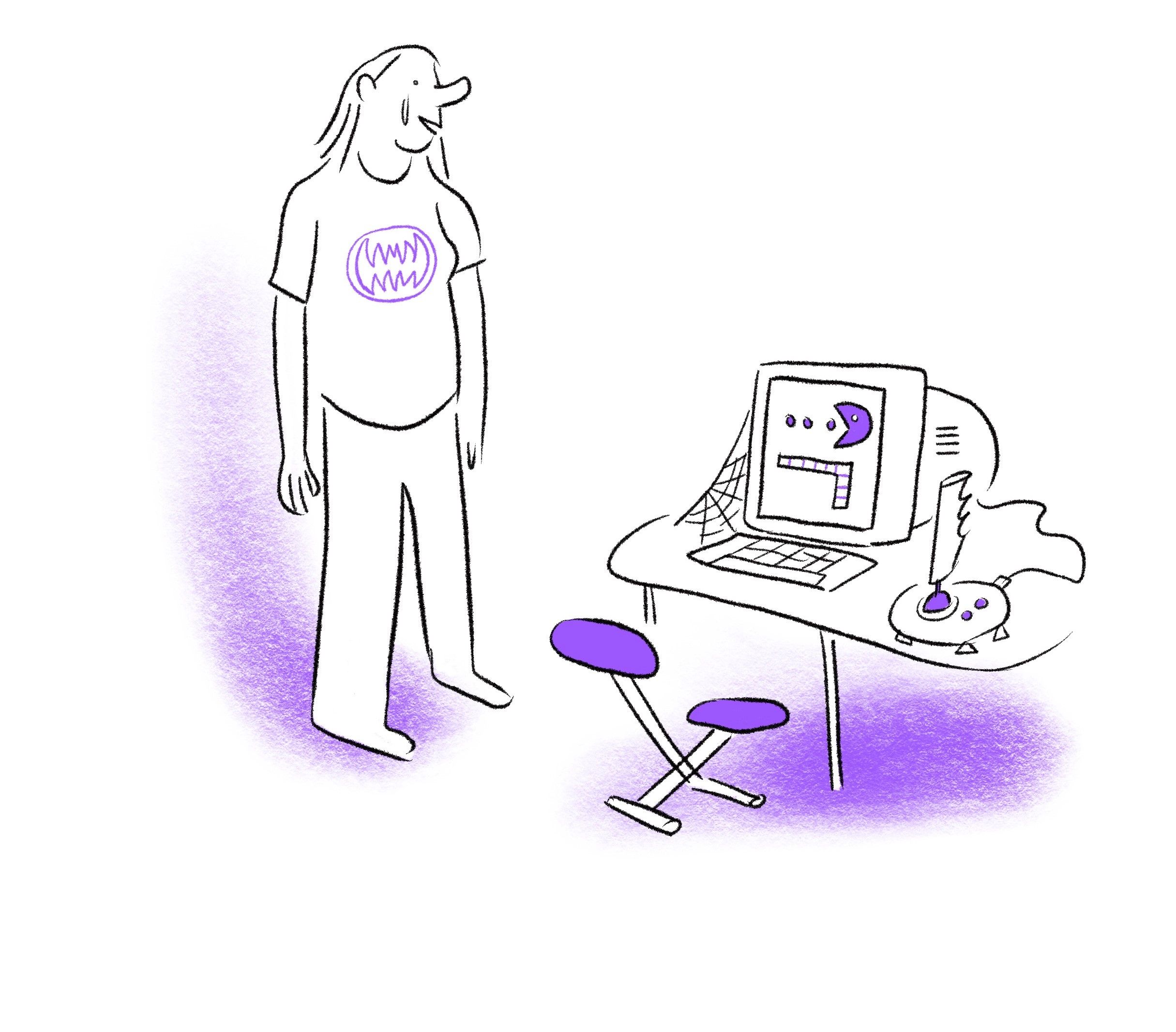 Illustration: Cyril Doisneau
Illustration: Cyril DoisneauLe développement de l’industrie du jeu vidéo au Québec a suivi un parcours assez similaire à celui du secteur des effets visuels et du cinéma d’animation. Si les deux premières entreprises locales — Behaviour Interactive et Kaydara — ont commencé leur activité de développement de jeux au début des années 1990, c’est la création du crédit d’impôt pour la production de titres multimédias en 1997 qui contribué à l’essor du secteur en ouvrant la voie à l’implantation de studios étrangers (Ubisoft, Eidos, Electronic Arts, WB Games et Gameloft).
On estime qu’un tiers des studios de jeux vidéo canadiens est situé dans la province, devançant ainsi la Colombie-Britannique et l’Ontario. Si la plupart d’entre eux se concentrent dans la région métropolitaine, plusieurs se sont implantés dans les régions de Québec, de Sherbrooke et de Saguenay. Aussi, la Guilde du jeu vidéo du Québec, qui représente les intérêts du secteur, compte désormais plus de 245 membres.
Le secteur du jeu vidéo s’est bâti sur un modèle d’affaires basé sur la prestation de services, sous l’impulsion des studios étrangers implantés dans la province. Aussi, cette partie de l’industrie se concentre sur les étapes de fabrication des productions; le développement et la commercialisation de propriété intellectuelle demeurent l’apanage des entreprises étrangères et sont gérés par leurs sièges sociaux.
Depuis 2015, on assiste à l’émergence de studios indépendants qui sont en mesure de développer, produire et commercialiser leurs propres propriétés intellectuelles.
Cette hausse du nombre de studios, ainsi que les nouveaux investissements étrangers, a fait bondir la valeur de l’industrie de 20 % entre 2017 et 2019, laquelle dépasse désormais le milliard de dollars (La Guilde du jeu vidéo du Québec 2021).
Cette croissance n’est pas sans incidence sur les besoins de main-d’œuvre. De plus, petits et grands studios convoitent les mêmes compétences et ne sont évidemment pas à armes égales en ce qui concerne leur capacité d’attraction et de rétention de talents.
Les studios membres de La Guilde du jeu vidéo du Québec emploient 13 000 personnes pour la région de Montréal et environ 4 000 dans le reste de la province. On prévoit la création de 2000 emplois dans les deux prochaines années, avec des salaires moyens de 75 600 $ (chiffres de 2019) (La Guilde du jeu vidéo du Québec 2021).
Les besoins de main-d’œuvre du secteur se situent autant au niveau des technologies de l’information (TI) qu’au niveau des compétences artistiques. Comme pour l’industrie des effets visuels et du cinéma d’animation, le recours à de la main-d’œuvre étrangère est la solution privilégiée pour répondre à la demande, particulièrement au niveau des postes intermédiaires et seniors (voir KPMG 2017, 2; Corbeil, Malouin et Khamassi 2016, 15)[^1].
Avec l’augmentation du nombre de studios indépendants qui développent et produisent leurs propres produits, des compétences en commercialisation, marketing et distribution devront être développées. De plus, pour poursuivre la croissance de l’industrie vidéoludique, notamment au-delà de la grande région métropolitaine, il faudra aussi miser sur le développement de compétences en gestion et en entrepreneuriat (voir Dagenais, Malouin et Arsenault 2017, 11‑14; KPMG 2017, 27; Corbeil, Malouin et Khamassi 2016, 20‑21).
[^1]: À ce sujet, on souligne que les problèmes qui limitent les possibilités de recrutement des entreprises des trois secteurs dépassent largement les enjeux d’adéquation formation-emploi ciblés dans ce rapport. On note, par exemple, des freins importants éprouvés par les studios relatifs aux structures administratives gouvernementales (provinciales et fédérales) afférentes à l’emploi et à l’immigration. L’un des enjeux notoires relevé est la désuétude actuelle du système de classification des professions (CNP) qui ne tient pas compte des professions émergentes pour lesquelles il y a une forte demande. L’Annexe C présente les données recensées sur les métiers des trois secteurs considérés dans l’enquête et propose une liste (non-exhaustive) des professions existantes qui ne sont actuellement pas incluses dans les listes de ce système de classification.